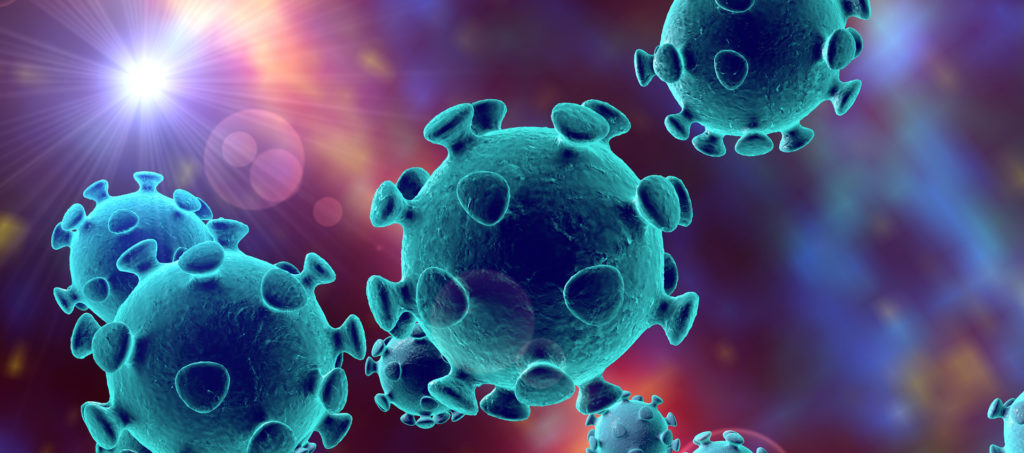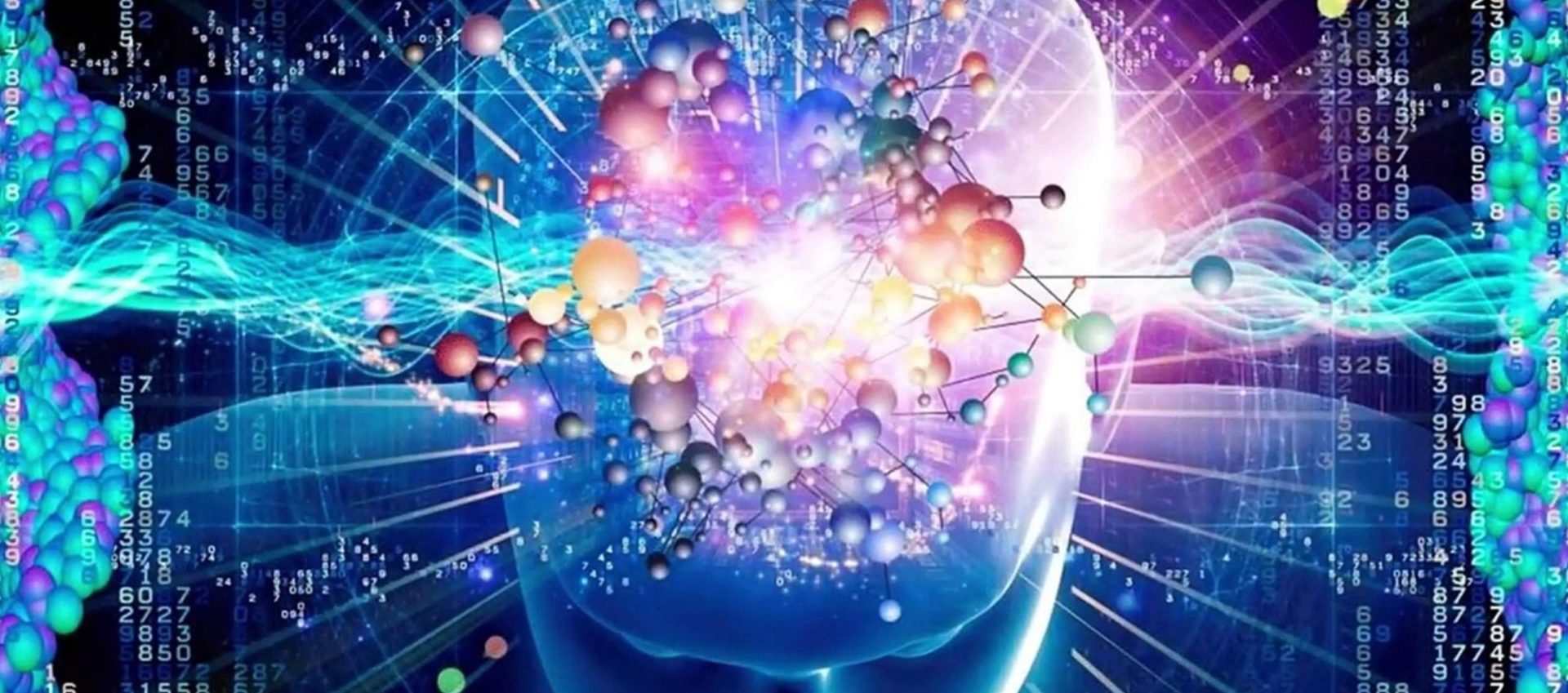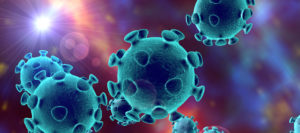Une connexion entre la planète, le climat et la santé mentale des êtres vivants
Le Greenlandic Perspective Survey nous apprend que 90 % des Groenlandais acceptent que le changement climatique (réchauffement climatique) se produise. Plus que cela, cela les rend anxieux et déprimés de voir les impacts sur les écosystèmes. Étant donné qu’ils vivent dans des conditions culturelles et climatiques qui les placent en première ligne du changement écologique, nous pourrions être bien avisés de prendre leurs pensées et leurs sentiments au sérieux. Où qu’ils aillent, nous pourrions très bien les suivre.
Aux extrémités opposées du spectre climatique (du paysage desséché de la Nouvelle-Galles du Sud à la fonte des glaces du Groenland) les gens ressentent le besoin de trouver de nouveaux mots pour décrire les problèmes de santé mentale liés au changement environnemental. En 2003, le philosophe australien Glenn Albrecht a inventé le terme de solastalgie pour décrire l’angoisse causée par les altérations de l’environnement dues aux sécheresses et à l’exploitation minière destructrice. Prenant le mot latin pour réconfort (sōlācium) et la racine grecque désignant la douleur (-algia), il nous donne un néologisme qui résume les effets dévastateurs de la recherche du malaise là où l’on avait l’habitude de chercher du soulagement et qui affecte la santé mentale de chacun.
Si le monde autour de vous promettait autrefois d’être un lieu qui fournit une certaine quantité de nourriture, d’abri et de consistance, comment pourriez-vous vous sentir alors qu’il devient progressivement un lieu d’extrême imprévisibilité et de risque ? Au Groenland, les Inuits du nord de Baffin ont le mot « uggianaqtuq » pour décrire le sentiment désagréable (de santé mentale) causé par le comportement étrange d’un ami, ou même un sentiment de mal du pays ressenti lorsqu’on est réellement chez soi. Plus récemment, ce mot a été coopté pour décrire les conditions climatiques instables de l’augmentation de température, de l’élévation du niveau de l’eau et le sentiment de ne plus être à l’aise dans son environnement. Les tempêtes se déchaînent plus soudainement et durent plus longtemps, la glace est plus mince et la nourriture est nettement plus rare. Alors qu’avant les causes du réchauffement climatique, vous pouviez subvenir à vos besoins grâce à la chasse, à la pêche et à la recherche de nourriture. Vous devez maintenant compléter ces activités par des sorties au supermarché nouvellement établi. Comment voulez-vous que ce type de population ne soit pas atteint dans leur santé mentale ? Mais surtout ! Comment sont-ils censés payer la nourriture ? Eux qui n’ont jamais eu ce type de train de vie.
À côté de ces termes plus spécialisés, nous avons aussi le « deuil écologique », plus explicite, et même l’idée d’une sorte de stress post-traumatique lié à l’état du réchauffement planétaire. Cette dernière idée peut sembler étrange. Comment la santé mentale peut-elle être post-traumatique alors que le pire est encore à venir ? Peut-on être traumatisé par quelque chose qui se produit encore ou même, selon certains, qui pourrait ne pas se produire du tout ?
Au XIXe siècle, le neurologue français Jean-Martin Charcot a établi un lien entre les symptômes apparemment non organiques de l’hystérie (un diagnostic qu’il pensait également pouvoir s’appliquer aux hommes) et la rapidité de la vie moderne. Il pensait que des accidents sans précédent liés aux machines industrielles et aux voyages mécanisés pouvaient avoir des effets traumatisants. Après avoir subi, ou même presque, un choc lié à la technologie, vous pourriez vous trouver incapable de le traiter mentalement. Tout cela est arrivé trop vite, trop fort, trop anormalement pour être pensable. L’esprit humain n’était tout simplement pas équipé pour faire face aux changements qui se produisaient dans le monde qui l’entourait.
Quoi que vous fassiez des catégories médicales désuètes et politiquement problématiques de Charcot, son idée d’une transformation impensable résonne sûrement. Pour tous, sauf pour les plus farouches d’entre eux, l’urgence climatique nie que quelque chose est définitivement en cours. Mais il est impossible de prévoir comment il se manifestera exactement et comment il se sentira. Par pure hypothèse, mais est-il vrai que nous n’ayons plus que 50 récoltes au rythme actuel de la consommation ? Y aura t-il des avantages à tirer de cette situation pour certains et des ravages climatiques et économiques pour d’autres ? Quel impact pourrait avoir une vaste réduction des ressources sur le comportement humain et sur leur santé mentale ?
Pour beaucoup, il semble que nous ayons déjà un pied planté dans un avenir insupportablement dystopique. Combien de temps faudra-t-il encore avant que les systèmes politiques ne s’effondrent et que nous ne nous retournions les uns contre les autres faute d’une santé mentale correcte en partant dans une frénésie pour les derniers morceaux de nourriture ? (Ou toute autre forme imaginable d’horreur de masse ?) Pour d’autres, ce genre de scénario est un délire, un symptôme de la panique médiatique. Ces deux « réalités » sont sujettes à caution. Qui peut dire qui est le plus en colère ?
La psychologie du déni de la science climatique
Pour que la réalité présente ressemble à un ensemble de conditions confortablement cohérentes, il faut inclure un calcul autour de l’avenir. Certaines personnes sont enclines à la catastrophe tandis que d’autres préfèrent effacer la possibilité de désagréments. On pourrait dire que ces deux tendances sont des tentatives d’auto-préservation. Faut-il agir de manière préventive pour éviter une catastrophe, s’exposer à des accusations d’anxiété pathologique, ou garder son calme et continuer au risque de paraître au mieux obtus ou au pire égoïstement destructeur ? Est-ce que c’est fou de faire le deuil de quelque chose avant de l’avoir perdu ?
C’est peut-être une question particulièrement poignante pour une génération de jeunes qui se demandent sérieusement s’il est ou non irresponsable d’avoir des enfants, beaucoup choisissant de ne pas le faire par crainte de ce que l’avenir proche leur réserve.
Dans un sens, toutes les réponses au climat écologique actuel sont folles, ou du moins exaspérantes. Prenez la menace au sérieux et risquez de succomber à la solastalgie, ou bien effacez-la et soyez accusé de vous écarter de la réalité. Dans le premier cas, vous vous énervez vous-même et dans le second, vous énervez les autres. Il peut parfois sembler que la seule réponse raisonnable soit la mélancolie, la colère et l’impuissance. C’est ce qu’a déclaré le Dr Courtney Howard, présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement : « L’intersection entre l’urgence climatique et la santé mentale et physique va devenir l’un des principaux problèmes du monde. »
Pour ceux qui ont l’oreille au sol, c’est évidemment déjà le cas.
D'autres sujets d'actualités
Santé Globale
Qui sommes-nous ?
Nous contacter
Politique de confidentialité